
Journées européennes du Patrimoine 2023
Dimanche 17 septembre : l’occasion rêvée pour venir nous visiter !
Le CREAM reçoit les visiteurs le dimanche 17 septembre à partir de 14 h, la dernière visite à 17h. Nous vous attendons nombreux à la découverte de notre patrimoine.
Nos patrimoines nous renvoient à notre propre histoire
Le « Patrimoine Vivant » peut être exprimé de différentes manières, notamment :
- Le « Patrimoine culturel immatériel » désigne les traditions, les pratiques, les expressions orales, les savoir-faire et les connaissances transmis de génération en génération.
- Les « Savoirs et traditions vivantes » représentent les connaissances et les pratiques qui sont continuellement recréées et partagées au sein d’une communauté.
- Les « Formes culturelles traditionnelles » englobent les expressions artistiques, les festivités, les rituels et les célébrations qui sont ancrés dans la culture d’une société.
- Les « Héritages culturels vivants » désignent les éléments culturels qui sont maintenus en vie et pratiqués activement par les communautés.
- Les « Manifestations culturelles traditionnelles » incluent les chants, les danses, les coutumes et les savoir-faire qui sont transmis et perpétués par les générations successives.
Il est important de souligner que ces termes sont utilisés pour décrire le même concept de patrimoine culturel immatériel, qui englobe les traditions, les connaissances et les pratiques vivantes transmises de génération en génération.
Accédez à l’intégralité de l’article en cliquant sur ce lien
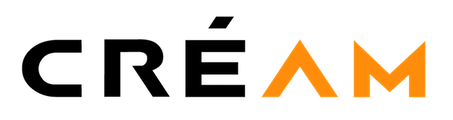
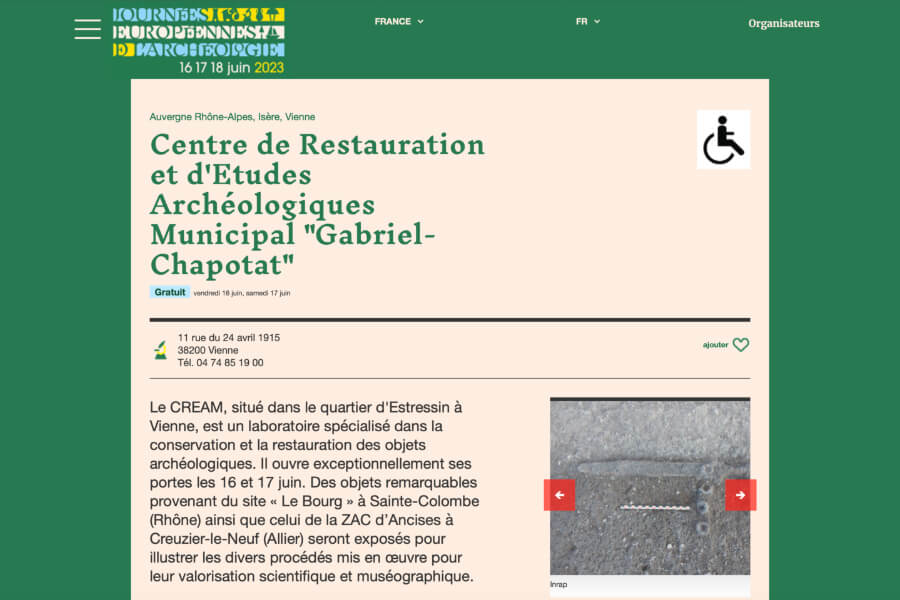





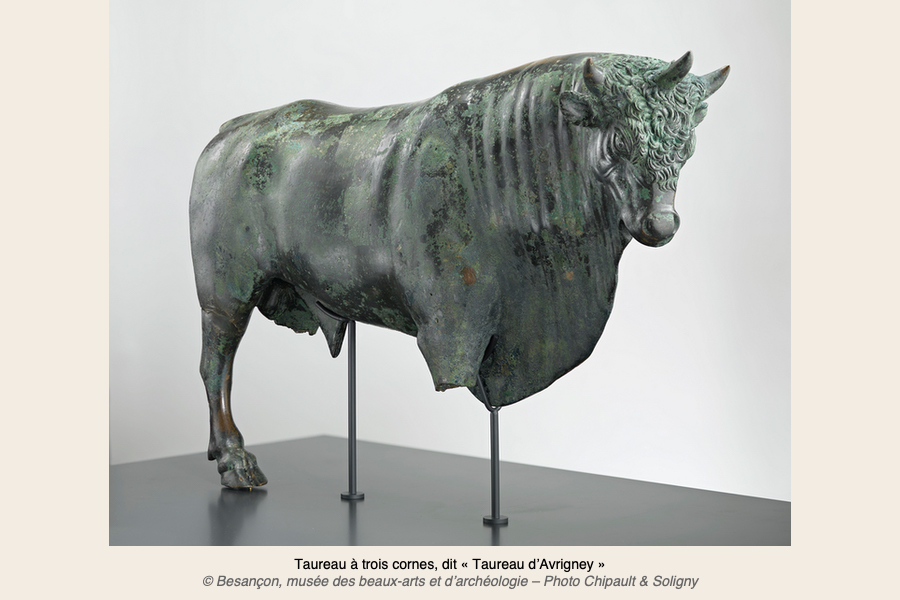
Commentaires récents